Le trust est une structure juridique permettant à une personne de transférer la gestion de ses biens ou droits à un tiers de confiance. Cette transmission peut s’effectuer du vivant du constituant ou prendre effet à son décès. L’administrateur gère alors ce patrimoine soit au profit de bénéficiaires désignés, soit pour atteindre un objectif spécifique. Pour ce qui est de la fiscalité des trusts, l’imposition des sommes versées par l’administrateur du trust (le trustee) au bénéficiaire varie selon leur origine.
Lorsque le bénéficiaire est également le constituant du trust, les sommes qu’il récupère et qu’il avait initialement placées ne sont pas soumises à l’impôt, sauf si l’administrateur les a prélevées sur les revenus capitalisés du trust. Cependant, il est fortement recommandé de solliciter l’expertise d’une avocate fiscaliste afin d’anticiper les risques liés à l’imposition et de défendre les droits des parties impliquées.
Dans le cas où le bénéficiaire n’est pas le constituant, il faut tenir compte des règles relatives aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Ainsi, seule la partie des sommes reçues qui dépasse le montant ayant déjà été soumis aux DMTG sera imposée en tant que revenus distribués.
Concernant la charge de la preuve, elle incombe à l’administration fiscale qui doit démontrer le caractère imposable des sommes versées. Toutefois, le bénéficiaire conserve la possibilité d’apporter la preuve que ces sommes ne sont pas imposables.
Quels trusts sont assujettis à la fiscalité française ?
La France a instauré en 2011 un dispositif fiscal spécifique aux trusts, dont le champ d’application est particulièrement étendu.
Les situations où le droit fiscal français s’applique
En effet, la fiscalité française s’applique dans plusieurs situations : lorsque le constituant (settlor), l’administrateur (trustee) ou l’un des bénéficiaires réside fiscalement en France.
Cette réglementation s’étend également aux trusts qui détiennent des actifs français ou perçoivent des revenus d’origine française, qu’il s’agisse de biens immobiliers ou de produits financiers.
Ce large éventail de critères de rattachement permet ainsi d’assujettir de nombreux trusts à la fiscalité française.
À titre d’information, la définition légale du trust, inscrite à l’article 792-0 bis du Code Général des Impôts, désigne un mécanisme juridique étranger par lequel un constituant transfère des biens ou des droits à un administrateur.
Ce dernier en assure la gestion soit au profit de bénéficiaires désignés, soit pour atteindre un but précis. Cette opération peut être réalisée du vivant du constituant ou prendre effet à son décès.
Cadre légal des trusts en France
Le droit fiscal français adopte une approche pragmatique : peu importe que le trust ait été formellement établi par la personne ayant apporté les biens ou par l’administrateur lui-même pour des raisons de discrétion.
L’administration fiscale considère systématiquement comme constituant la personne qui a effectivement placé ses biens dans le trust.
L’imposition en France peut alors être déclenchée par plusieurs situations. À savoir le décès du constituant ou des bénéficiaires assimilés à des constituants, la distribution de biens aux bénéficiaires, ou encore la détention d’actifs entrant dans l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière.
La charge fiscale peut dans l’un de ces cas peser sur différents acteurs. Notamment le constituant, les bénéficiaires après le décès du constituant ou l’administrateur, ce dernier pouvant être tenu solidairement responsable de certaines obligations en matière de fiscalité des trusts.
Les situations qui déclenchent l’imposition des trusts
Le déclenchement de l’imposition en France peut survenir dans trois situations principales. Soit au décès du constituant ou des bénéficiaires assimilés à des constituants, lors de la distribution de biens aux bénéficiaires, ou en cas de détention d’actifs relevant de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
La charge fiscale se répartit alors entre le constituant, les bénéficiaires (particulièrement après le décès du constituant), et l’administrateur qui peut être tenu solidairement responsable de certaines obligations fiscales.
Cette structure juridique particulière nécessite donc une attention rigoureuse aux différents événements pouvant déclencher une imposition et aux personnes susceptibles d’en supporter la charge.
Cela dit, les produits versés aux bénéficiaires par un trust, tel que défini à l’article 792-0 bis du CGI, sont imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers. Cela quelle que soit la nature des biens ou droits placés dans ce dispositif (article 120, alinéa 9 du CGI).
Depuis 2018, ces revenus sont soumis, au choix du contribuable, soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % sans abattement, soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux.
Par ailleurs, les revenus non distribués et réinvestis dans le trust ne sont généralement pas soumis à l’imposition.
Quand est-ce que les résidents fiscaux Français sont concernés par la fiscalité des trusts ?
L’article 1649 AB du Code général des impôts (CGI) impose à l’administrateur d’un trust deux obligations déclaratives : une déclaration événementielle et une déclaration annuelle.
Ces obligations s’appliquent dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :
- Tout d’abord, elles concernent les cas où le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France, conformément à l’article 4 B du CGI, au 1ᵉʳ janvier de l’année de déclaration.
- De même, elles s’appliquent si au moins un des bénéficiaires du trust est résident fiscal français selon les mêmes dispositions.
- Par ailleurs, ces obligations déclaratives s’étendent aux situations où l’un des biens ou droits placés dans le trust est situé en France, conformément à l’article 750 ter du CGI. Cette condition doit être vérifiée au 1ᵉʳ janvier de l’année pour ce qui est de la déclaration annuelle.
- Les administrateurs de trusts domiciliés fiscalement en France, définis à l’article 792-0 bis du CGI, sont également soumis à ces obligations.
- Enfin, elles s’appliquent aux administrateurs de trusts résidant ou établis en dehors de l’Union européenne lorsqu’ils acquièrent un bien immobilier en France. Ou qu’ils établissent une relation d’affaires sur le territoire français, conformément à l’article L. 561-2-1 du Code monétaire et financier.
En somme, la gestion d’un trust nécessite une bonne compréhension des obligations fiscales. Il est fortement conseillé de consulter un avocat fiscaliste pour anticiper les risques et se conformer aux règles complexes.
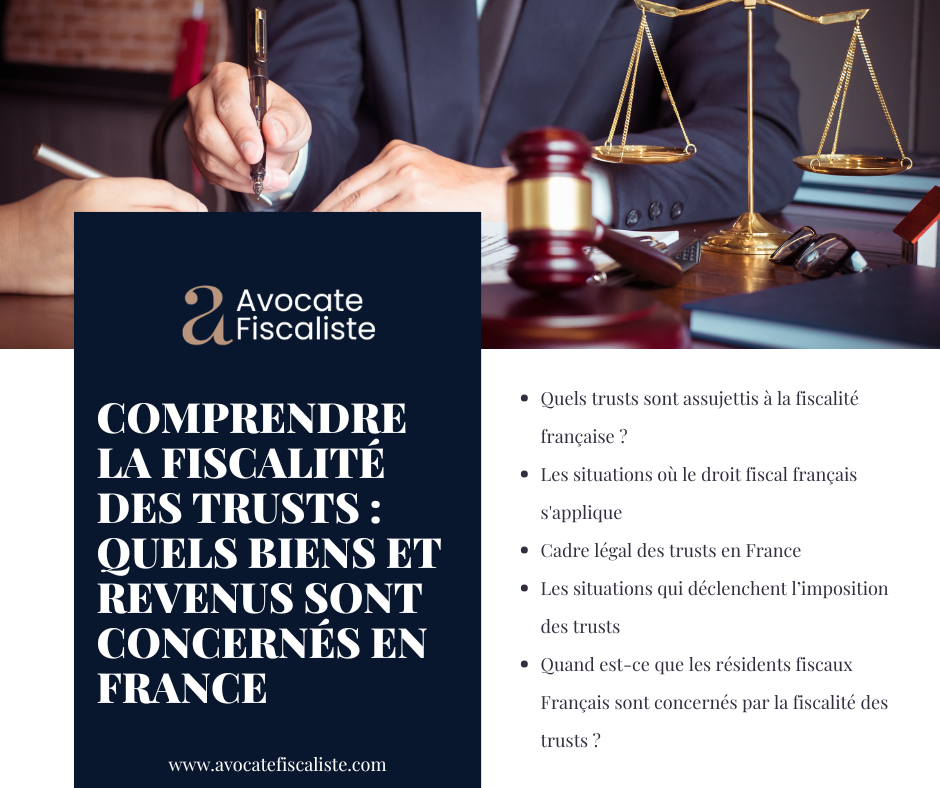
FAQ : Tout savoir sur la fiscalité des trusts en France
Les trusts sont-ils imposés en France ?
Oui, la France impose les trusts dès lors que le constituant, l’administrateur ou un bénéficiaire réside en France. Les trusts détenant des actifs situés en France sont également soumis à la fiscalité française.
Quelles sont les obligations déclaratives d’un trust en France ?
L’administrateur du trust doit effectuer une déclaration annuelle et une déclaration événementielle dès lors qu’un élément du trust est lié à la France (bénéficiaire, constituant, biens, etc.).
Quels sont les risques fiscaux pour un bénéficiaire d’un trust ?
L’administration fiscale peut requalifier certains versements en revenus imposables ou en droits de mutation à titre gratuit. Il est donc essentiel de bien anticiper les implications fiscales avec un avocat fiscaliste.
Pourquoi faire appel à un avocat fiscaliste pour gérer un trust ?
Un avocat fiscaliste vous aide à comprendre les obligations légales, à anticiper les risques fiscaux et à optimiser la gestion du trust pour éviter toute requalification ou taxation excessive.



